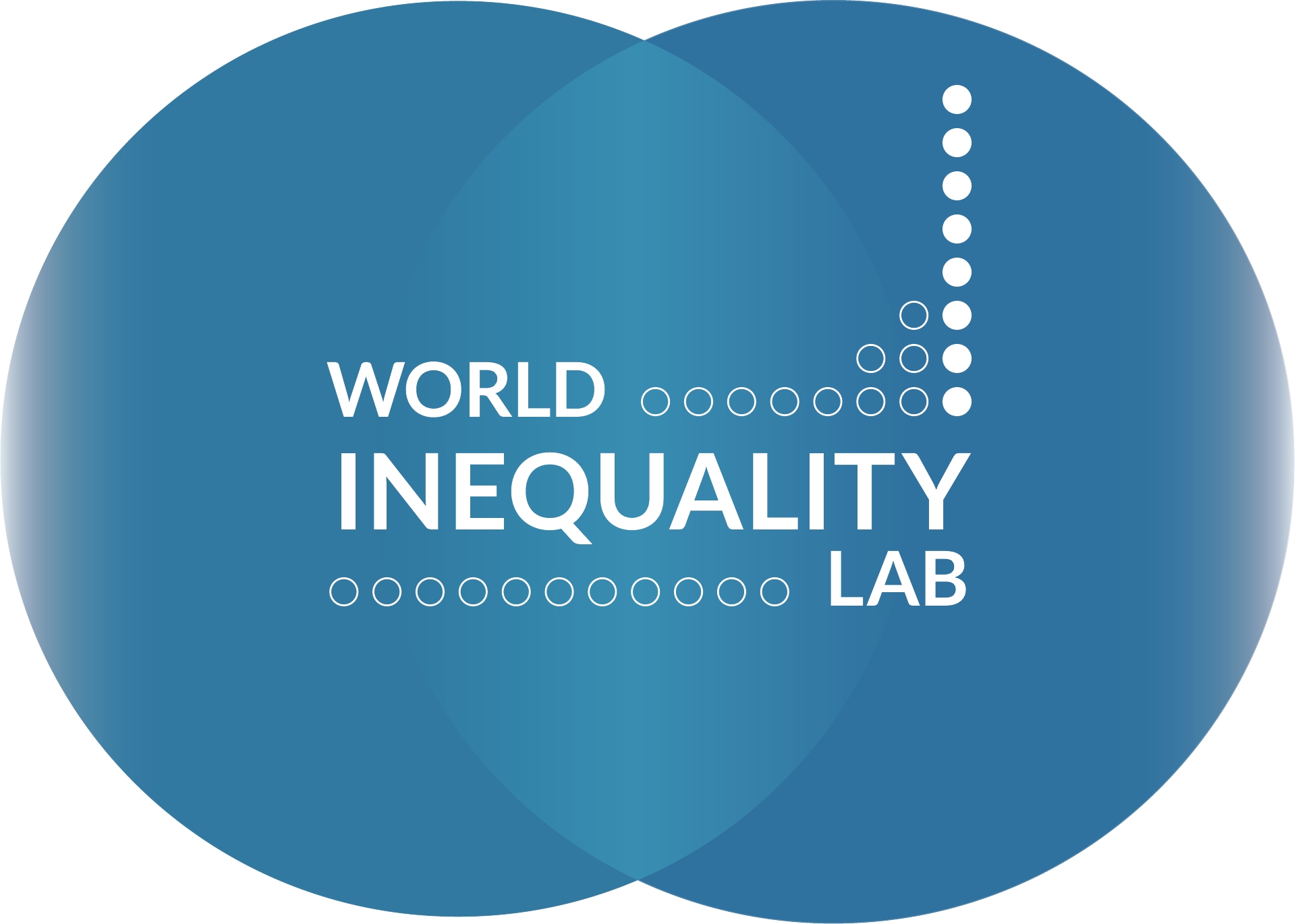"La démocratie jusqu'au bout"
Le Monde, samedi 12 juillet 2014
Propos recueillis par Jean Birnbaum
Economiste et chercheur en sciences sociales, Thomas Piketty est le lauréat du prix Pétrarque de l'essai France Culture-Le Monde 2014 pour son livre Le Capital au XXIe siècle (Seuil). Ce prix récompense un essai qui éclaire les enjeux démocratiques contemporains. Thomas Piketty prononcera, lundi 14 juillet, à Montpellier, la « Leçon inaugurale » des Rencontres de Pétrarque, organisées par France Culture et Le Monde, dans le cadre du Festival de Radio France, sur le thème « De beaux lendemains ? Ensemble, repensons le progrès ».
Le Monde : Dans votre livre, vous citez Condorcet et son « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain » (1794), emblématique d'un certain optimisme des Lumières, qui structure encore largement notre imaginaire politique. Or la discordance que vous constatez au XXe siècle entre d'un côté, les progrès réalisés sur le plan démocratique, et de l'autre, l'accroissement des inégalités sociales, dynamite cette vieille conception du progrès…
Thomas Piketty : Je suis très marqué par le débat français sur l'égalité. Une partie des élites de la IIIe République, vers 1900-1910, affirme que, la Révolution étant accomplie, la France n'a pas besoin de l'impôt progressif sur les revenus et les successions ; les sociétés aristocratiques, britannique notamment, en auraient bien besoin, mais pas la France, qui a réalisé, elle, l'égalité juridique… Or cet espoir dans le fait qu'une égalité des droits formels allait suffire à produire une société plus juste a été en partie une supercherie. Et c'est uniquement pour financer la guerre, avec la loi du 15 juillet 1914, qu'on a créé l'impôt progressif.
On dit que la France est pionnière pour l'égalité, mais en réalité, elle est l'un des derniers pays à avoir créé cet impôt. Et ce, justement, à cause d'une certaine foi dans le progrès spontané, naturel… Dans ces conditions, le mot républicain lui-même légitime les inégalités les plus extrêmes, et d'investir par exemple trois fois plus de ressources publiques dans les filières élitistes qu'à l'université.
La conclusion que j'en tire, ce n'est pas que le progrès est impossible, mais qu'il faut repenser les institutions de politique publique dans toute une série de domaines (fiscalité, transparence, éducation…). Pour que la République soit sociale, une vraie démocratisation de l'économie et l'accès au savoir s'impose. Il faut plus que la Révolution française et l'égalité formelle pour que le progrès se réalise.
Longtemps, la gauche a nourri l'espoir d'un progrès en ligne droite, qui prendrait la forme d'une « marche » triomphale vers la justice. Les désastres du XXe siècle l'ont obligée à envisager le progrès comme quelque chose de moins linéaire, et ceux qui se battent pour l'émancipation sociale se sont mis à « brosser l'histoire à rebrousse-poil », comme disait le philosophe Walter Benjamin. Votre essai ne s'inscrit-il pas dans cette même remise en cause ?
Je me considère plus comme un chercheur en sciences sociales que comme un économiste. En tant que tel, je suis porteur d'un certain optimisme, je crois à une délibération démocratique qui permet de compléter, assez radicalement parfois, l'Etat de droit. J'ai cet élément d'espoir dans mon activité, mais en même temps j'ai eu l'occasion d'observer qu'au XXe siècle, les institutions progressistes n'ont pas été le produit d'un long fleuve tranquille.
Ainsi, ce sont les guerres mondiales et la menace de la révolution bolchevique qui ont poussé les élites, notamment en France, à changer leur vue. Le Bloc national, une des chambres les plus à droite qui aient existé, vote en 1920 l'impôt sur le revenu à 60 % alors qu'il le refusait quelques années plus tôt à 2 % : il était alors considéré comme spoliateur ! Donc, effectivement, la réalité des rapports de forces fait que l'histoire est faite de ruses. Mais remettre en perspective ces retournements passés permet d'appréhender la suite d'une manière plus informée. En particulier, je tente de lutter contre une nationalisation excessive du débat : beaucoup d'identités nationales se jouent autour d'histoires concernant l'argent, le revenu, le patrimoine… Et beaucoup des chocs historiques que l'on observe sont aussi des réponses à la manières dont les pays se perçoivent eux-mêmes, racontent leur propre histoire par rapport aux autres.
Je pense qu'il est possible de dépasser ces mécanismes nationaux, pour apprendre davantage des autres.
Précisément, vous évoquez souvent votre expérience et vos recherches aux Etats-Unis. La lutte contre les inégalités et, plus largement, l'espérance de progrès ne sont pas toujours envisagées de la même manière de part et d'autre de l'Atlantique. Comment décririez-vous cette différence de vue ?
On l'a oublié depuis les années Reagan, mais pendant longtemps, les Etats-Unis étaient plus égalitaires que la vieille Europe. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, la concentration du capital y est plus faible. Et c'est parce que les Américains ont peur de se rapprocher des niveaux d'inégalités européens qu'ils inventent l'impôt progressif sur le revenu et les successions. De 1930 à 1980, le taux supérieur de l'impôt fédéral sur le revenu est de 80 %, ce à quoi il faut ajouter les impôts des Etats. Ces niveaux d'imposition s'appliquent pendant un demi-siècle, visiblement sans tuer le capitalisme américain… Et s'il y a un basculement sous les années Reagan, c'est à cause de la peur d'un rattrapage des pays ruinés par la seconde guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon. Reagan utilise cette peur pour prôner un retour à un capitalisme débridé. Quant à l'idée américaine du progrès, elle est le fruit d'une histoire propre, avec cette particularité d'un pays en croissance perpétuelle, et dont la population ne cesse d'augmenter.
Ils étaient 3 millions lors de la déclaration d'indépendance, ils sont plus de 300 millions aujourd'hui ; par comparaison, les Français étaient presque 30 millions lors de la Révolution française, ils sont maintenant 66 millions. En France, donc, les patrimoines hérités sont forcément plus importants que dans un pays qui n'a pas d'histoire et où la population a été multipliée non par deux mais par cent durant la même période. Aux Etats-Unis, le sentiment de progrès se nourrit donc d'abord de cette réalité : l'extension indéfinie, qui conduit à une certaine tolérance aux inégalités, parfois difficile à comprendre pour nous, mais qui s'explique par le fait qu'une partie importante des 50 % qui sont placés les plus bas sur l'échelle de répartition des revenus ne sont pas nés aux Etats-Unis. Mais ce mécanisme a ses limites et suscite ses tensions propres.
Vous affirmez qu'il n'y a pas de fatalité, que la démocratie sociale peut se bâtir en créant un rapport de forces politique. Pourtant, certains chercheurs ou militants vous font reproche de ne pas proposer une articulation entre vos idées et les mobilisations sociales qui pourraient les porter.
J'essaye de mettre en cohérence une recherche savante avec un engagement public. Pour cela, il faut prendre des risques, s'engager sur des conclusions possibles. De ce point de vue, je crois dans le pouvoir des idées, je crois dans le pouvoir des livres. Toutes les manifestations d'opinion et de savoir sont des éléments de mobilisation sociale, économique et politique. Pour moi, le rapport de forces est aussi politique et intellectuel.
Les représentations qu'on se fait ont une influence sur les choses. Je tente d'écrire cette histoire politique de l'inégalité au XXe siècle. Mon travail est de mettre un livre à la disposition de chacun. Je ne dis peut-être pas assez comment des nouvelles formes de mobilisation peuvent s'en saisir, mais je souhaite que chacun s'en saisisse. Je suis convaincu que des outils analytiques et conceptuels élaborés pour analyser les inégalités peuvent avoir une répercussion politique. On n'écrit pas un livre pour les gens qui nous gouvernent : de toutes les manières, ils ne lisent pas de livre. On écrit des livres pour tous les gens qui en lisent, à commencer par les citoyens, les acteurs syndicaux, les militants politiques de toutes tendances.
Votre livre se joue des frontières. Entre économie et sciences sociales, mais aussi entre sciences sociales et littérature. Selon vous, qui veut éclairer le destin des inégalités doit faire appel aux écrivains. Pourquoi ?
Je fais jouer à la littérature le rôle qu'elle a joué dans mon propre questionnement sur les inégalités. Et c'est un rôle essentiel. Poser la question des inégalités, c'est poser celle des relations de pouvoir entre les groupes sociaux, et donc celle de nos représentations collectives. Notamment aux XVIIIe et XIXe siècles, car c'est une période où l'absence d'inflation fait que les montants monétaires ont un sens : à l'époque, on peut évoquer l'argent sans ennuyer le lecteur parce qu'il renvoie à des styles de vie et des rapports de domination très déterminés. Si Balzac dit 1 000 livres de rente, et pas 10 000 livres, on comprend d'emblée le type de vie que cela implique, avec qui il est possible de parler, de se marier, c'est toute la vie qui défile…
Je n'aurais jamais représenté l'inégalité comme je le fais sans la lecture de Balzac. Il y a là, dans la littérature, une puissance évocatrice qu'aucun chercheur en sciences sociales ne peut approcher. Les chercheurs font autre chose, qui peut aussi être utile, mais sans atteindre cette vérité, cette puissance. Mettre des concepts théoriques et des constructions statistiques là-dessus, ce n'est jamais qu'un pauvre résumé, et en même temps, cette médiocre production statistique est importante pour la régulation démocratique de nos sociétés, pour lutter contre les inégalités.
Mon travail de chercheur est un travail de tâcheron : je collecte des données, des sources, des archives. Il n'y a pas besoin de talent littéraire pour ça ; la seule chose qu'il faut, c'est du temps et un peu de détermination.
A des jeunes qui s'adresseraient à vous en reprenant, à propos du progrès, la vieille question kantienne : « Que nous est-il permis d'espérer ? », quelle serait votre réponse ?
Je répondrais qu'il est possible de développer une vision optimiste et raisonnée du progrès. Pour cela, il faut miser sur la démocratie jusqu'au bout. Il faut s'habituer à vivre avec une croissance faible, et sortir des illusions héritées des « trente glorieuses », où la croissance allait tout régler. La réflexion sur les formes concrètes de la démocratisation de l'économie et de la politique, sur la façon dont la démocratie peut reprendre le contrôle du capitalisme, cette réflexion ne fait que commencer. Il est urgent de développer des institutions réellement démocratiques, au niveau européen comme au niveau local, avec de nouveaux modes de participation collective aux décisions et de réappropriation de l'économie.
Ce n'est pas parce que le XXe siècle a été marqué par des chocs violents et des échecs terribles qu'il ne faut pas reprendre cette page, presque blanche, du progrès.