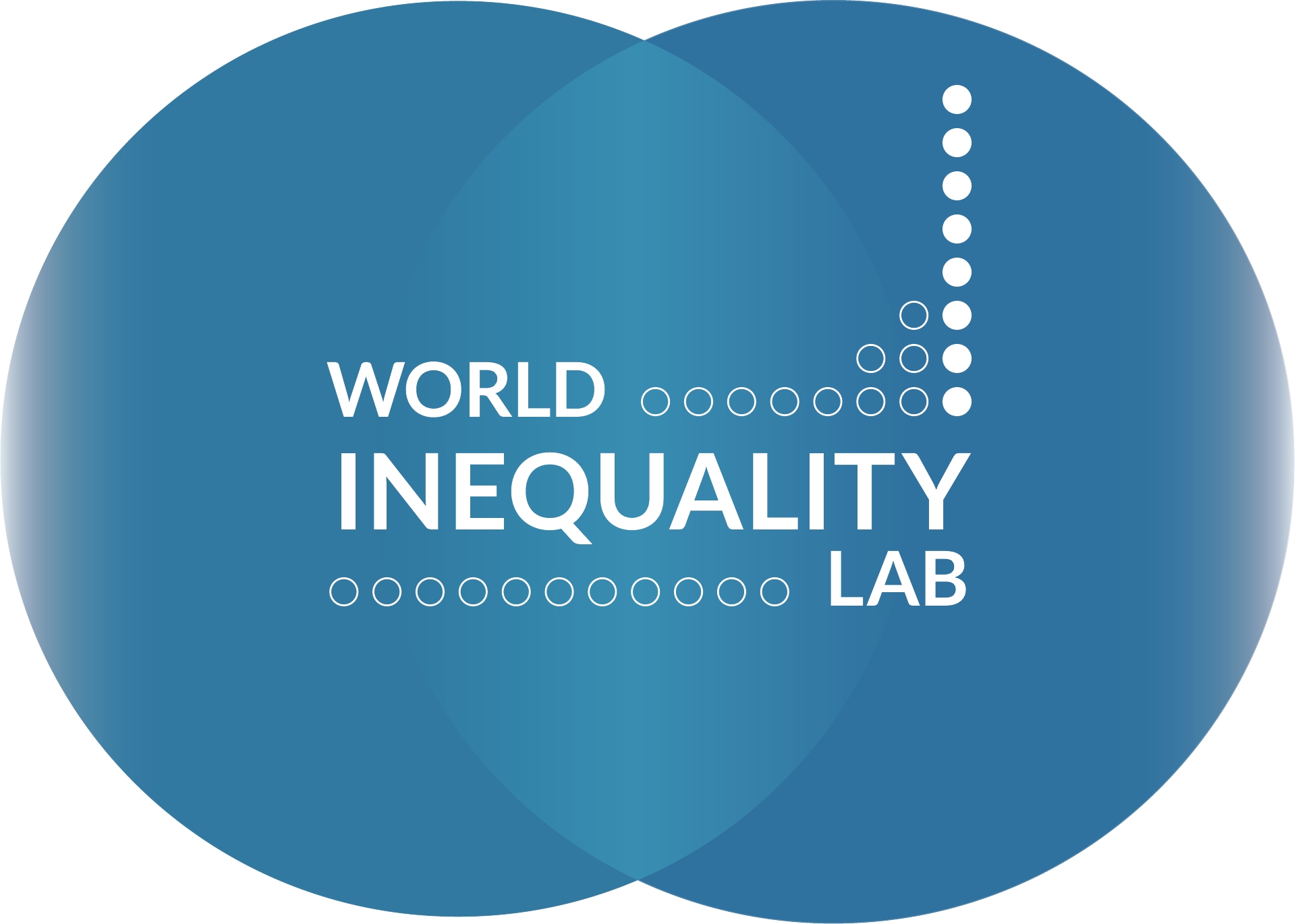Le capital en Afrique du Sud
Thomas Piketty est directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'Ecole d'économie de Paris
Libération, mardi 6 octobre 2015
Un peu plus de vingt ans après la fin de l’Apartheid et les premières élections libres (1994), l’Afrique du Sud s’interroge plus que jamais sur la question des inégalités. Le massacre de Marikana, où 34 mineurs en grève pour des augmentations de salaire avaient été abattus par la police en août 2012, continue de hanter les esprits.
L’ANC (African National Congress), au pouvoir sans interruption depuis le début de la transition démocratique, a permis la mise en place de l’égalité des droits civiques fondamentaux : droit de vote, droit de se déplacer sur le territoire et d’occuper en principe toutes les professions. Mais cette égalité formelle n’a pas permis de réduire l’inégalité abyssale des conditions de vie et des droits réels : droit à un emploi et un salaire décents, droit à une éducation de qualité, droit d’accéder à la propriété, droit à une réelle démocratie économique et politique. Le pays s’est développé, la population s’est fortement accrue (30 millions en 1980, 55 millions aujourd’hui), mais la promesse d’égalité a été déçue.
Selon les dernières données disponibles, les 10% les plus favorisés captent environ 60-65% du revenu national, contre 50-55% au Brésil, 45-50% aux Etats-Unis, 30-35% en Europe. Pire encore : cet écart extrême séparant les 10% du haut (qui demeurent très majoritairement des blancs) des 90% du bas s’est aggravé depuis la fin de l’Apartheid.
Ce triste constat s’explique en partie par des facteurs internationaux : dérégulation et explosion des rémunérations financières (secteur très important en Afrique du Sud), hausse des cours des matières premières (bénéficiant surtout à une mince élite blanche), dumping fiscal et social généralisé.
Mais il s’explique aussi par l’insuffisance des politiques menées par l’ANC. Les services publics et éducatifs disponibles dans les zones les plus défavorisées demeurent d’une qualité médiocre. Aucune réforme foncière ambitieuse n’a été menée, dans un pays où les noirs se sont vus retirés le droit de posséder la terre et ont été parqués dans des réserves et des townships depuis le « Natives Land Act » de 1913 jusqu’en 1990. Le patrimoine foncier, immobilier et financier demeure largement aux mains de l’élite blanche, de même que les ressources minières et naturelles. Les timides mesures de « Black Economic Empowerement » (BEE), visant à obliger les actionnaires blancs à céder une fraction de leurs actions à des noirs, sur la base de transaction volontaire aux prix du marché, n’ont bénéficié qu’à une infime minorité de noirs qui avait déjà les moyens – ou les réseaux politiques – pour se porter acquéreurs.
Résultat prévisible : l’ANC est de plus en plus contestée sur sa gauche par le parti des « Economic Freedom Fighters » (EFF), qui proposent une série de mesures radicales : éducation et sécurité sociale pour tous, redistribution des terres, nationalisation des ressources minières. La minorité blanche (14% de la population en 1990, à peine 9% aujourd’hui) s’affole : la semaine dernière, une députée blanche, sorte de Morano locale, réclamait le retour du dernier président de l’Apartheid.
Pour reprendre la main, l’ANC pourrait mettre en place dès 2016 un salaire minimum national et utiliser cet outil pour réduire les inégalités, à l’image du Brésil sous Lula. Certains imaginent également la mise en place d’un impôt progressif sur le capital, permettant de redistribuer graduellement le pouvoir économique. Déjà envisagé entre 1994 et 1999, le projet avait finalement été abandonné par l’ANC. Selon l’ancien président MBeki, la police et l’armée, encore dirigées à ce moment par des blancs, ne l’auraient pas permis.
Une chose de sûre : qu’il s’agisse de nationalisation minière, ou simplement de tout projet visant à mettre à contribution les sociétés multinationales et les détenteurs de patrimoines de façon plus significative qu’aujourd’hui, l’Afrique du Sud aurait bien besoin de la coopération des pays riches, et non plus de notre hypocrisie. L’élite financière sud-africaine le répète à loisir : dans les années 1980, nous étions obligés de négocier, mais aujourd’hui nous pouvons facilement transférer nos fonds à l’étranger et dans des paradis fiscaux.
De fait, l’opacité financière internationale est un véritable fléau pour l’Afrique : on estime qu’entre 30% et 50% des actifs financiers du continent sont détenus dans des paradis fiscaux (contre 10% pour l’Europe).
Pour peu que l’Europe et les Etats-Unis le décident, par exemple dans le cadre du traité transatlantique en préparation, il serait pourtant techniquement facile de mettre en place un véritable registre mondial des titres financiers. Comme l’explique Gabriel Zucman dans « La richesse cachée des nations » (Le seuil, 2014, dont la traduction sort actuellement aux Etats-Unis), il suffirait que les autorités publiques unifient et prennent le contrôle des dépositaires privés qui jouent actuellement ce rôle (Clearstream et Eurostream en Europe, Depository Trust Corporation aux Etats-Unis).
L’Afrique n’a pas besoin d’aide ; elle a simplement besoin d’un système légal international qui lui évite d’être pillée en permanence.